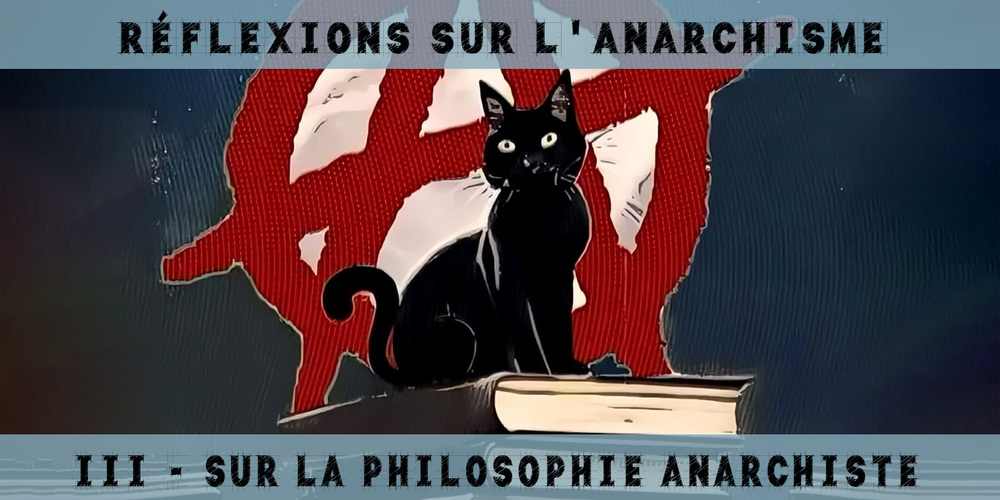Accueil > Editions & Publications > Volonté anarchiste > 01 - Réflexions sur l’anarchisme - Maurice Fayolle > III - Sur la philosophie anarchiste
Le bien et le mal
Le survol de la déjà longue histoire humaine montre qu’il a toujours existé au sein des sociétés, même les plus primitives, au moins un embryon de morale, dont la singularité est de vouloir distinguer le bien du mal.
À travers les époques comme à travers tous les régimes, les religions successives furent sans cesse le support privilégié, sinon unique, de ce besoin impératif qu’éprouve toute collectivité humaine de réglementer son existence en l’insérant dans un cadre strictement codifié.
Je ne pense pas que les religions aient « inventé » la morale. Je suis plutôt porté à croire que les religions naissantes se sont servies, pour imposer leur domination, de cette espèce d’instinct qui, sous l’aiguillon de la nécessité, pousse toute société d’êtres vivants, animale aussi bien qu’humaine, à se discipliner pour survivre.
Mais si, dans les sociétés animales, cette discipline (qui atteint sont point culminant chez les termites, les fourmis et les abeilles) s’est instaurée avec une rigueur mécanique qui n’a d’autre ressort que l’instinct de conservation de l’espèce, dans les sociétés humaines, l’intelligence, dans un désir qui est la manifestation même de son existence, a voulu expliquer et justifier ce besoin impératif de discipline par des considérations métaphysiques.
Ainsi naquit la philosophie, dont l’objet est une tentative sans cesse renouvelée d’explication et de justification de la vie humaine. Or, l’aventure philosophique, en quoi se condense toute l’histoire de l’esprit humain, est une manifestation à la fois nécessaire et vaine.
Nécessaire, lorsqu’elle a pour objectif d’exprimer en termes humains ce besoin impératif de discipline dont les racines plongent dans l’animalité ; vaine lorsqu’elle prétend rechercher une explication et une justification de la présence humaine sur ce monde terrestre.
L’humain est et cette certitude physique est la seule base sérieuse sur laquelle puisse reposer une philosophie raisonnable et sensée. Rechercher le pourquoi de cette existence, c’est poursuivre une chimère dans les mirages scintillants des cieux, des au-delà et des olympes : tous ces lieux irréels enfantés par la fertile imagination humaine pour servir de royaumes à l’imposante cohorte des divinités qui se succédèrent tout au long des siècles.
Dans l’impossibilité de trouver une explication humaine à sa propre existence, l’homme en rechercha la cause dans le divin. Ce fut le triomphe des religions qui, dans un délire imaginatif insensé, enrobèrent les successives morales, nécessaires à l’existence des sociétés humaines, dans un fatras de tabous, d’interdits et de rites, où se diluèrent l’essentiel et l’indispensable au profit du superflu et de l’inutile.
Ce fut le règne du bien et du mal – le bien étant ce qui était bénéfique à la puissance de la religion existante, le mal ce qui lui était contraire. Sous des formes variables, toutes les religions symbolisèrent le bien sous les traits d’une divinité bienfaisante, le mal sous ceux d’une autre divinité, malfaisante celle-là : le bon Dieu et le diable de la religion chrétienne. Avec, pour complément, l’ineffable ciel pour les bons et le terrifiant enfer pour les mauvais : cosmologie enfantine à la mesure de l’enfance humaine.
Ainsi se dilua dans le parfum des encens, les psalmodies incantatoires et les divagations théologiques, les origines profondes du besoin impératif de discipline qu’éprouvèrent les premières sociétés humaines, imitant en cela les sociétés animales dont elles étaient issues. La morale, perdant alors les bases naturelles qui lui sont propres, bascula dans le carnavalesque déploiement d’une fantasmagorie sacrée, sans lien avec la réalité, sans utilité pour l’espèce, souvent homicide pour les individus, toujours néfaste pour la société.
On pourrait remplir des volumes rien qu’à décrire les différentes conceptions qu’inventèrent les religions pour définir le bien et le mal, base essentielle de toute morale. À travers les temps et les lieux, ces conceptions varièrent dans des limites telles que le bien devenait le mal et inversement.
La sacralisation de la morale ne pouvait qu’aboutir à ces inepties et à ces contradictions. En fait, il ne peut y avoir de bien et de mal par référence à une divinité quelconque – pas plus qu’à l’humain ou à la société considérés comme entités. Une saine morale ne peut se référer qu’à l’humain – et à lui seul – considéré dans sa réalité vivante et sensible.
Discipliner la vie d’une société en exprimant en langage humain les lois élémentaires qui sont indispensables à sa survie et à son bonheur est une chose nécessaire – et c’est la tâche des philosophes. Institutionnaliser et sacraliser une morale qui, sous prétexte de sauver l’humain du péché, l’enferme dans une prison et le paralyse dans une camisole est une autre chose – et ce fut l’inutile et néfaste travail des théologiens.
Démystifier la morale est une œuvre absolument nécessaire.
Comme l’a fort bien démontré Pierre Kropotkine dans son admirable livre L’Entraide, la vraie morale ne saurait être autre chose que la connaissance, le respect et la pratique des grandes lois naturelles qui, hors de tout esprit religieux, tendent à maintenir la vie et la cohésion d’un ensemble sociétaire.
Quelles sont ces lois ? La première et la plus importante est, sans conteste, la solidarité, dont la charité n’est que la déformation religieuse et caricaturale. Aucune société humaine (pas plus qu’aucune société animale) ne peut vivre et prospérer si ne s’y pratique pas un minimum de solidarité entre ses membres.
La solidarité entre membres d’un groupe humain (qu’il soit composé de quelques unités ou de quelques centaines de millions) est la base essentielle sur laquelle doit reposer toute morale. Point n’est besoin pour cela de rechercher des justifications extraterrestres : l’humain est et ne peut survivre qu’au sein d’une communauté. C’est une loi impérative de la nature et une saine morale ne saurait chercher d’autres sources.
Mais, si l’on ne veut sombrer dans la rigueur mécanique qui a amené certaines sociétés animales à un parfait et effrayant degré d’automatisme, il faut humaniser les grandes lois naturelles qui viennent du fond des âges et que nous avons hérité du règne animal.
C’est pourquoi la première de ces grandes lois naturelles, celle de la solidarité, ne saurait avoir, chez l’humain comme chez l’animal, pour seule fin, la préservation ou la multiplication de l’espèce.
Par son esprit qui a fait de lui une unité pensante, l’humain a des ambitions qui sont au-delà du seul instinct. Partie intégrante d’une communauté hors de laquelle il ne pourrait exister, l’être humain ne saurait non plus sacrifier sa vie sensible et éphémère aux dévorantes exigences d’une société qui, elle-même, ne pourrait exister sans les individus.
La solidarité humaine doit donc se définir dans la perspective d’une morale qui exprime l’équilibre le plus harmonieux possible entre le bien d’une société, communauté nécessaire à la vie, et le bien des individus, réalités vivantes de cette société.
C’est ainsi que « Liberté, Égalité, Fraternité », ce sigle qui orne le fronton de tous nos édifices et qui, faute d’être devenu une réalité, est tombé dans l’oubli et l’indifférence, demeure l’expression la plus valable de l’exigence humaine qui veut que l’ancestral instinct de solidarité s’individualise en dépassant le seul objectif de l’espèce.
Désacraliser la morale en la débarrassant des inutiles mythes religieux ou laïques qui l’ont défigurée et mutilée, la rendre à sa vocation naturelle en l’exprimant dans le langage humain de la solidarité, reste la tâche d’une philosophie révolutionnaire conséquente.
La liberté entre la puissance et la justice
La vie humaine, l’existence de l’humain sur la terre dans son comportement social –et, au-delà, par extension et multiplication dans les expressions morales d’une société et un temps et un milieu déterminés– sont conditionnées en partie par trois facteurs psychologiques qui se définissent par trois ”volontés” : la volonté de puissance, la volonté de liberté et la volonté de justice.
Toute l’aventure humaine, du couple jusqu’aux grands ensembles, depuis ses origines jusqu’à nos jours, toute sa longue et douloureuse histoire dans la lente succession de ses paix éphémères et de ses tueries renouvelées, de ses guerres et de ses révolutions, de ses saints et de ses tyrans, de ses régimes et de ses morales, est imbriquée dans le jaillissement et les heurts de ces trois volontés, tour à tour créatrices et destructrices, aussi bien des individus que des peuples.
Mon propos est de montrer que la volonté de puissance et la volonté de justice étant situées exactement aux pôles opposés de l’entendement humain, la volonté de liberté s’insère à la charnière de ces deux expressions opposées et peut ainsi apporter son aide, son appui et son dynamisme indifféremment à l’une ou à l’autre de ces volontés opposées.
Définissons d’abord les deux extrêmes : la volonté de puissance et la volonté de justice.
Qu’est-ce que la puissance ? Elle s’illustre et se concrétise par l’emprise de UN sur les AUTRES – que ce UN soit un homme, un chef de famille dans le cadre de la famille, un chef tribal dans le cadre de la tribu, un chef d’État dans le cadre d’une nation ou d’un empire ; ou que ce UN soit une caste, une classe, une coterie. Individuellement aussi bien que collectivement, la puissance implique la domination : c’est l’autorité imposée du père, du chef, de la classe ou de la caste. Politiquement, elle s’exprime par les régimes autoritaires : monarchie, théocratie, oligarchie, aristocratie – ou par la dictature, fasciste ou dite du prolétariat.
Mais son expression collective ne doit pas faire oublier son origine individuelle : la volonté de puissance est avant tout un acte individuel. Ce n’est qu’à la longue et à la faveur de certaines circonstances particulières (économiques surtout) qu’elle se mue en une volonté de puissance collective d’un clan, d’une classe, d’une caste – d’une nation ou d’un empire – d’une religion ou d’une idéologie.
Essayons d’en faire l’autopsie. À la base de cette volonté de puissance, on trouve le désir de l’individu de se libérer des contraintes familiales, religieuses, politiques ou économiques qui entravent son élan vital vers la réalisation de ses désirs – c’est-à-dire vers ce qu’il conçoit comme étant les conditions de son bonheur. En d’autres termes, la volonté de puissance trouve sa source dans un désir de liberté conçu POUR SOI – dans une liberté sauvage qui s’acquiert par le combat, la lutte, l’écrasement des AUTRES à son profit. Son expression est donc bien la domination et sa justification philosophique tient dans cette certitude que, la liberté n’étant pas indéfiniment extensible, il faut, pour conquérir SA liberté, s’approprier celle d’autrui – sa liberté, d’abord, puis le fruit de son travail et, ainsi, l’exploitation apparaît comme le complément inévitable de la domination. Une telle philosophie exprime la réalité des sociétés esclavagistes.
C’est ainsi que, dans une certaine perspective, on ne peut faire aucune différence entre un chef d’État et un chef de bande, entre un capitaine d’industrie, d’armée ou de brigands, entre un financier et un voleur – entre un gang de trafiquants, une société anonyme et une classe exploiteuse. Ce sont, très exactement, les mêmes mobiles qui les animent : se libérer eux-mêmes en dominant, en asservissant, en spoliant, en volant ceux qui les entourent. Et, au point de départ, il s’agit d’une identique révolte contre les contraintes sociales. Ainsi, la volonté de puissance trouve, paradoxalement, ses arguments et ses mobiles dans un désir de libération – dans la volonté. de liberté !
Et c’est à la même source que, à l’opposé de la volonté de puissance, la volonté de justice va aller chercher ses arguments et ses mobiles. Seulement cette fois – et c’est toute la différence – la perspective philosophique change. Celui qui est animé par la volonté de justice pense que la liberté n’est pas limité, mais que, au contraire, elle est indéfiniment extensible – ce qui ne veut pas dire qu’elle puisse être immédiate et totale : là comme ailleurs, la loi de l’évolution impose des processus, des paliers, des étapes qui sont conditionnés par le niveau politique, économique, intellectuel et moral de l’ensemble social en un lieu et une époque déterminés – mais que la direction à suivre est celle d’une plus grande et égale liberté pour tous.
Il serait vain, je crois, de parler à ce propos d’altruisme. L’humain, animé par la volonté de justice, pense simplement – et c’est évident – que, selon le propos de Bakounine, il trouvera une plus grande liberté dans un milieu libre et non dans un milieu asservi où, pour asservir, le ou les dominateurs sont obligés de créer une armature étouffante de règles, de lois et morales qui finissent par les asservir eux-mêmes.
On voit, par ce court exposé, que le désir de libération à l’état brut, sauvage, peut, comme les fameuses langues d’Esope, être la meilleure ou la pire des choses. Si, à l’origine, c’est essentiellement une révolte contre ce qui est, c’est-à-dire contre l’ordre établi (famille, religion, société, travail, etc.), qui, dans les mailles de leurs multiples contraintes, briment les désirs d’évasion ; si, à l’origine, c’est donc un sursaut sain et naturel, c’est aussi un élan qui dégénère ou s’élève suivant qu’il sombre dans la volonté de puissance ou qu’il tend vers une volonté de justice.
Or, toute notion de justice sociale implique nécessairement la notion de l’égalité : c’est, en effet, l’inégalité des conditions qui crée l’injustice au sein des sociétés. Si bien que de nos jours, et malgré les progrès acquis après tant de siècles de lutte, l’existence simultanée d’un économiquement faible et d’un milliardaire exprime toujours la persistance de structures sociales esclavagistes : hors d’une revendication permanente à l’égalité, la liberté conquise par l’individus n’est plus, en définitive, que celle de la bête lâchée dans la jungle.
Ce qui veut dire que la liberté réelle ne saurait être, socialement, une conquête individuelle et solitaire –car elle débouche alors inévitablement sur la volonté de puissance – sur la tyrannie et le brigandage. La vraie liberté ne peut être que le fruit d’une conquête collective, dont l’objet sera d’établir un système social, politique et économique, où les inégalités seront réduite au minimum, et conçu de telle sorte que la volonté de liberté qui habite l’humain ne serve pas à opprimer son semblable, mais, au contraire, contribue à la liberté de tous.
Pour parvenir à ce résultat, il faudra nécessairement supprimer ce chancre des sociétés individualistes et autoritaires : l’attrait de la richesse – la possibilité de s’enrichir. L’une des premières mesures à prendre par une révolution sociale conséquente devra donc être la suppression de l’argent – je ne dit pas de la monnaie–, mais de l’argent sous sa forme thésaurisable. Une société libre, égale et fraternelle ne saurait se concevoir tant que subsistera le mirage fascinant de la fortune, qui désagrège les consciences les mieux trempées et qui, depuis les temps les plus reculés, a toujours constitué la plus grande source d’inégalité – et de tentation. Cette tentation qui fait basculer le naturel désir de liberté des humains vers les flammes scintillantes et meurtrières de la puissance où, tout au long des siècles, sont venus se brûler et s’anéantir les individus et les peuples.
Choisir la liberté
Sur le plan philosophique, l’anarchisme se définit clairement et sans ambiguïté par rapport à tous les autres systèmes philosophiques : il s’oppose au principe d’autorité et lui oppose le principe de liberté.
À ce niveau, son argumentation est irréfutable : elle s’appuie, en effet, sur une très longue expérience vécue : celle de l’histoire humaine prise dans la totalité de ses dimension temporelles et géographiques. Et ce avec une telle constance que nulle réfutation n’apparaît possible. L’Histoire est là, en effet, pour démontrer que, partout et toujours, dans tous les temps et tous les lieux, l’autorité et la liberté se sont constamment opposées. Cette opposition permanente, on la retrouve dans toutes les branches de l’activité humaine, en politique aussi bien qu’en religion, en art aussi bien qu’en science : contre l’autorité qui prétend imposer le silence et l’immobilité, la liberté se dresse pour contester et revendiquer la parole et le mouvement. Mieux encore, cette opposition fondamentale, on la retrouve à l’état mythique dans la plupart des grandes théologies : c’est la révolte de Prométhée contre Zeus, aussi bien que celle de Satan contre Dieu. Au-delà des mythes, qui sont toujours la transposition imagée d’une réalité, l’Histoire démontre ainsi que l’autorité a toujours été l’idéal, le moteur et l’arme des gouvernements, des dominateurs, des maîtres ; la liberté, l’idéal, le moteur et l’arme des gouvernés, des opprimés, des esclaves.
Toutes les démonstrations, toutes les arguties dialectiques ne peuvent rien contre cette évidence : autorité et liberté sont, non des fictions philosophiques, mais bien des réalités vivantes de la vie des humains. Elles s’opposent en thermes irréconciliables, mais ne peuvent se nier, ni s’ignorer : toute la vie des sociétés repose sur leur équilibre instable. Entre ces deux adversaires, il n’y a jamais de coexistence pacifique, mais seulement des périodes plus ou moins longues de paix armée, des trêves que viennent rompre, soit un sursaut de l’autorité (réaction), soit une offensive de la liberté (révolution). Après quoi, un nouveau cycle recommence – une nouvelle veillée d’armes.
Mais cette lutte incessante que se livrent l’autorité et la liberté, ce n’est, en définitive, que l’expression philosophique d’une réalité sociale bien définie : le combat qui dresse en permanence ceux qui subsistent contre ceux qui asservissent. Autorité et liberté deviennent ainsi les deux termes symétriques et opposés d’une unique proposition : la lutte de classe.
De sorte qu’on peut poser comme un axiome démontré par l’analyse historique que : a) un accroissement de l’autorité provoque toujours une régression des libertés ; b) un gain des libertés se fait toujours au détriment de l’autorité.
Jusqu’à ce point, la démonstration est irréfutable : tout est clair, net, logique. La difficulté commence à partir du moment où l’on veut situer, « dimensionner » la liberté – et, par contrecoup, l’autorité – dans le contexte de la vie sociale.
Peut-on supprimer toute autorité ? Peut-on concevoir une liberté illimitée ? En posant ces questions, nos adversaires affectent le souverain et railleur mépris de ceux qu’une certitude illumine : laissons ces adorateurs de l’autorité et ces contemplateurs de la liberté se bercer dans un sommeil qui leur dissimule le mouvement de l’Histoire : on ne vend plus d’humains enchaînés sur les places de nos marchés.
Mais, parmi les anarchistes eux-mêmes, des camarades s’interrogent : l’autorité est néfaste, mais peut-on concevoir un monde sans autorité ? La liberté est le but suprême des aspirations humaines, mais ne risque-t-elle pas, sans limites et sans frein, de basculer dans le chaos ? En d’autre termes, l’anarchie n’est-elle pas une utopie et le combat que nous menons un mirage ? Ce sont des questions embarrassantes, mais auxquelles il faut répondre.
Précisons tout de suite un point important : l’autorité dont il est question ici est celle qui s’impose à autrui par la contrainte, la violence ou la peur – et non celle qui s’impose naturellement par son rayonnement moral. Il s’agit donc de cette autorité qui, dans la société, s’exprime par la puissance et se manifeste par la domination. Quant à la liberté, il s’agit, évidemment, du droit que doit (ou devrait) avoir tout humain d’agir sans contrainte.
Le problème social que pose la dualité de l’autorité et la liberté a été magistralement étudié par Proudhon, notamment dans ce livre que ne devrait ignorer aucun anarchiste : Du principe fédératif.
Le fondateur de l’anarchisme social y est très clair : autorité et liberté sont des réalités coexistantes et opposées dans tous les régimes. D’où il en tire une classification logique en : A - régimes d’autorité : a) monarchie ou patriarcat (gouvernement de tous par un seul) ; b) panarchie ou communisme (gouvernement de tous par tous) ; et B - régimes de liberté : a) démocratie (gouvernement de chacun par chacun) ; b) anarchie (gouvernement de chacun par chacun). Ceci étant une classification théorique. En fait, ni l’autorité ni la liberté n’existent à l’état pur dans aucun régime. Il s’ensuit des combinaisons variables qui donnent naissance à des régimes hybrides. Cependant, dans les deux premiers cas, la primauté est à l’autorité, dans les deux seconds, la primauté est à la liberté.
Il ne s’agit là que d’une différence, mais elle est essentielle : les deux catégories de régimes s’opposent puisqu’ils tendent vers des finalités opposées : le premier tend vers une toujours plus grande concentration de l’autorité ; la seconde vers une toujours plus grande extension de la liberté. Mais à ce niveau de l’argumentation intervient une donnée philosophique d’une importance considérable : celle d’un rejet, d’un refus catégorique de toute conception finaliste de l’Histoire. En effet, l’évolution, c’est-à-dire le mouvement de l’histoire ne peut s’achever que de deux manières possibles : par la perfection atteinte, à partir de laquelle il n’y aurait plus de mouvement, donc plus d’Histoire, ce qui est absurde ; ou par la fin de l’Histoire, c’est-à-dire par la disparition de l’espèce humaine, ce qui hors de discussion.
Toutes ces considérations sont, je crois, nécessaires, pour bien situer le problème de la liberté et de l’autorité, pour définir les « dimensions » de la liberté en société anarchiste.
« La révolte n’est nullement une revendication de la liberté totale ». Disons-le donc nettement, la liberté anarchiste ne saurait être celle de piétiner les plates-bandes d’un parc public ou d’en dévaster les massifs fleuris. Pas plus que celle d’ignorer le code de la route en roulant à gauche ou en brûlant les feux rouges. À la liberté DE l’individus s’opposent la liberté, le bien et la sécurité DES individus. Ceux-ci sont donc parfaitement le droit de placer des gardes et des agents là où il est nécessaire, afin d’empêcher de nuire ceux qui veulent nuire.
Mais alors quelle différence avec la société autoritaire ? Ces différences seront au nombre de deux et capitales : le « service d’ordre » sera orienté vers la prévention et non vers la répression, comme c’est le cas actuellement ; et les membres de ce service d’ordre seront nommés, non par le pouvoir, mais par les collectivités intéressées, responsables devant elles et révocables par elles.
Soyons réalistes. La société idéale est un mythe, puisqu’elle suppose la perfection. La société à construire, la société anarchiste sera un régime qui, au-delà de la démocratie et plus qu’elle, sera orienté vers la liberté. À travers des structures changeantes, parce qu’adaptables aux formes changeantes de l’évolution, elle tendra vers le self-government, le « gouvernement de chacun par chacun », selon la définition de Proudhon, vers une perfection qui ne sera jamais atteinte intégralement. Dans la société la plus autoritaire, il existe toujours des parcelles de liberté. Dans la société libertaire, il demeurera des parcelles d’autorité, dont l’important diminuera au fur et à mesure que les humains apprendront mieux l’usage de la liberté.
Entre les deux pôles opposés autour desquels se cristallisent les société humaines, il faut faire un choix clair et décisif : ou l’autorité avec son cortège de « grandeur » et d’esclavage ; ou la liberté avec ses difficiles pratiques.
Les anarchistes ont choisi la liberté.
| II - Sur l’organisation de la société |
- Lire : Avant-propos
- Lire : I - Sur l’organisation du mouvement
- Lire : II - Sur l’organisation de la société
 PARTAGE NOIR
PARTAGE NOIR